Quand j’étais petite, enfant unique, je suppliais mes parents de me donner un petit frère ou une petite soeur. En plus, je n’étais même pas exigeante : je n’avais aucune préférence, l’un ou l’autre m’aurait convenu ! Mais mon voeu n’a pas été exaucé, pour des raisons diverses : mes parents ne roulaient pas sur l’or, j’étais moi-même une enfant très souvent malade et qui demandait beaucoup d’attention…
Jusqu’à mes dix ans. Un jour, ma mère m’a annoncé qu’elle était enceinte. Toute la famille a sauté de joie, moi en particulier. Et puis, au bout de quelques temps, mon père m’a annoncé qu’il n’y aurait pas de petit frère ou de petite soeur. Ma mère avait perdu le bébé (je n’ai compris que beaucoup plus tard qu’il s’agissait d’une fausse couche, mais à l’époque l’impact était le même : c’était tout un potentiel de vie qui s’effondrait).
À lire aussi : « Je me suis sentie très seule, presque abandonnée » : comment j’ai survécu à ma fausse couche
Je vais avoir une petite sœur !
Elle s’appellera Elissa, comme la reine de Carthage
Onze ans. Ma mère tente de nouveau d’avoir un bébé, elle m’en parle. Je suis un peu inquiète, je pense que ça ne va pas marcher. Et puis un jour j’accompagne ma mère au laboratoire pour obtenir des résultats. Elle déplie le papier, le lit, et me demande tout d’un coup « tu veux savoir si je suis enceinte ? .» Bien entendu, je ne risquais pas de répondre par la négative, même si l’appréhension montait dans mon corps de fillette. Et là, le visage de ma mère s’illumine : « je suis enceinte » !
Ce fut le début d’une grossesse ordinaire. Les échographies, l’annonce aux ami•e•s et à la famille, et pour moi, la fierté à l’école : je vais avoir une petite sœur ! On se met, tout doucement, à acheter les vêtements, les affaires de bébé. Je suis ravie d’aller avec ma mère choisir tout cela dans les magasins, et je veux absolument participer au choix du prénom. Elle s’appellera Elissa, comme la reine de Carthage. Ma mère est fan d’antiquité, et aime les prénoms peu communs. Bien sûr, il fallait aussi que cela sonne bien en arabe, puisque mon père est Syrien. Je parle déjà à ma petite soeur dans ma tête, je lui dis que je prendrai soin d’elle.

Huit mois de grossesse. Un jour, alors que je joue dans la rue avec ma meilleure amie, mes deux parents m’appellent. Ils vont à la maternité en urgence, ma mère doit accoucher par césarienne. Il y a un problème avec le bébé. Mais sur le moment, je ne comprends pas qu’il est un peu tôt pour l’accouchement. Je suis juste ravie que ma petite soeur arrive bientôt.
L’hôpital. Blanc, éclat du métal, froid. Blouses blanches. Comme l’enfant innocente que je suis, je gambade dans les couloirs. Ma mère et mon père sont avec moi, je vais voir ma soeur pour la première fois.
Je l’attends depuis des années. Et maintenant elle est là.
Elle est si minuscule. Deux kilos, les yeux bandés (peut-être pour la protéger de la lumière, elle qui n’est pas encore complètement formée), ses petits poings fermés. Je l’admire. Je l’aime depuis déjà si longtemps. Je l’attends depuis des années. Et maintenant, elle est là.
Ma mère m’explique qu’Elissa est en couveuse : ma mère a eu des contractions anormalement tôt, pour une raison inconnue, et cela faisait du mal au bébé, alors ils ont provoqué l’accouchement par césarienne et ont mis ma soeur dans cette petite boîte de plastique chauffée, pour qu’elle puisse terminer de se développer. En effet, le gynécologue n’a pas su déceler qu’elle avait un important retard de développement et qu’elle était en réalité beaucoup moins formée qu’elle n’aurait dû l’être à ce stade de la grossesse.
« S’il te plaît, ne meurs pas »
Insidieusement, je sens que malgré tout, quelque chose ne va pas. Je suis un peu inquiète, même si ma soeur paraît être entre de bonnes mains, que l’accouchement s’est bien passé… et qu’elle est là. Elle ne peut pas disparaître. Oui mais. Mon intuition de petite fille, déjà, murmure au fond de ma tête. J’ai onze ans, je ne connais rien à la médecine ; tout ce que je peux faire, c’est me pencher sur la couveuse et murmurer à ma soeur : « s’il te plaît, ne meurs pas, je t’aime ».
Six jours plus tard, je rentre de l’école. Étrangement, c’est une voisine et amie de ma mère qui m’ouvre la porte. Elle me prend dans ses bras, m’embrasse, et m’installe à la table du salon. Je ne comprends pas. Elle ne dit rien de spécial, elle attend juste avec moi. Curieuse, je ne pose pas de questions et me tiens sagement assise.
Quelques minutes, une éternité plus tard, mes parents arrivent à leur tour à la maison. Par la fenêtre, je les vois sortir de la voiture. Je ne comprends pas. Ils devraient être à la maternité, ma soeur n’est pas prête à sortir de l’hôpital. Je vois que les bras de ma mère sont vides. Ceux de mon père aussi. Je sais, mais je refuse de comprendre. Il doit y avoir une explication. Je regarde l’amie de ma mère, toujours à mes côtés. Je ne pose pas de questions. Je sais.
Fille unique, de force
Nous avons enterré ma soeur dans un petit village près de Damas. Elle a droit à une pierre tombale, à une cérémonie chrétienne et à deux poèmes récités par des amis de mes parents : un en français, un en arabe. Curieusement, c’est lorsque j’entends le poème en arabe, que je ne comprends pourtant pas, que je me mets à pleurer.
Je ne l’avais pas assez aimée, cette petite
Pendant les années qui ont suivi, j’ai toujours cru que j’étais coupable. Je ne l’avais pas assez aimée, cette petite. Ce n’est pas possible autrement. Si je l’avais aimée assez fort, si j’avais cru en elle, elle aurait survécu. Si je n’avais pas bousillé le ventre de ma mère en naissant, les choses seraient différentes. Je n’en parle pas, sauf à ma meilleure amie. Elle a 14 ans à l’époque, et elle ne sait pas comment réagir.
Je me fais à l’idée de ne pas avoir de frère ou de soeur. Cela ne veut pas (plus) dire que je suis fille unique, même si c’est ce qu’on raconte aux gens. On ne va pas se mettre à déballer notre vie à chaque nouvelle rencontre et plomber l’ambiance dès le départ, n’est-ce pas ? Pourtant j’ai honte. J’ai l’impression de renier ma soeur.
L’arrivée du premier frère
Et puis, quand j’ai quinze ans, j’apprends que ma mère est enceinte. Je vous passe les détails de comment ça a pu avoir lieu, parce que ça concerne la santé de ma mère et sa vie privée. Toujours est-il que quand j’ai eu 16 ans, ma mère était enceinte d’un petit garçon. À l’époque, j’avais complètement changé d’attitude : pour ne pas risquer d’avoir à nouveau le coeur et la tête brisés, je n’espérais plus. S’il venait au monde et qu’il survivait, tant mieux. Sinon… je ne me serais, au moins, pas fait d’illusions. Si bien que pendant toute la grossesse de ma mère, je n’y croyais pas vraiment.
Elle allait perdre ce bébé, ou il mourrait durant les premières semaines de sa vie. Il n’y avait pas d’alternative ; je ne pouvais pas avoir de frère. J’étais maudite. J’apportais le malheur à ma famille.
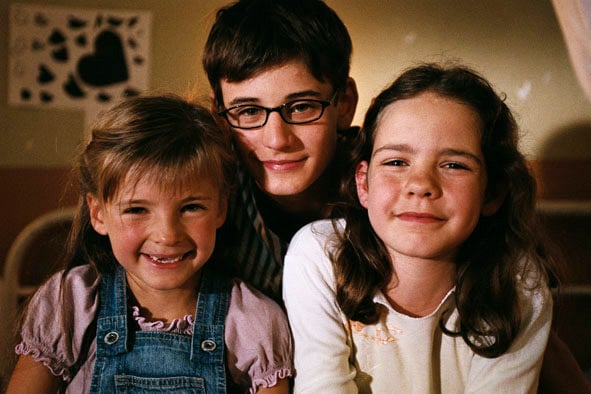
Le jour où ma mère est inscrite pour une césarienne, je suis en France, avec mon père. Elle n’avait pas voulu faire l’erreur d’accoucher en Syrie une deuxième fois — la question « aurait-on pu sauver Elissa si ma mère avait accouché en France ? » restait scotchée dans les esprits comme un papier tue-mouches. Je suis donc chez ma grand-mère, et j’attends que mon père, parti à la clinique avec ma mère à deux heures de là, m’appelle pour me dire que l’accouchement s’est bien passé.
Je n’espère plus… juste que ma mère va bien
J’attends. J’attends encore. Une heure passe. Puis deux. Puis une demi-heure de plus. Puis dix minutes de plus. Bientôt, chaque minute creuse un peu plus mon coeur déjà meurtri. Je ne savais pas que j’espérais encore, mais l’espoir tue à petit feu. Je suis pendue au téléphone, je ne le lâche pas de la matinée, j’étends même le linge d’une seule main pour ne pas avoir à le poser. Il est midi. Je n’espère plus… juste que ma mère va bien.
13 heures. Je vais voir ma tante, qui attend également des nouvelles. Je ne me savais pas autant sur les nerfs, je m’en aperçois lorsque, à sa simple question « ça va ? », je fonds en larmes. Elle me demande si je m’inquiète. Je fais oui de la tête. Je ne respire plus. Ce petit frère, malgré moi, j’y ai cru.
14 heures, la délivrance. Le téléphone sonne. C’est mon père, le bébé va bien, ma mère va bien, l’accouchement s’est passé on ne peut mieux, tout le monde va bien, la césarienne a simplement dû être retardée, je pleure, je laisse couler toute cette eau hors de mon corps, je n’en peux plus. Je respire à nouveau.
Dans les semaines, les mois qui suivent, je suis le bébé partout. Il s’appelle Aurélien, il a de grands yeux bleus et des cheveux noirs épais, il est grand et dodu, il est en excellente santé. Jusqu’à ses six mois, toutes les nuits, je me lève une, deux, trois fois par nuit pour vérifier qu’il respire.
Une soeur… ou une mère ?
Nous avons seize ans de différence, Aurélien et moi. Il pourrait être mon fils — c’est d’ailleurs ce que pensent les gens dans la rue. Je souris, j’explique que c’est mon frère. Je suis fière. Je m’occupe de lui aussi bien que ma mère, je sais le nourrir, changer sa couche, l’endormir, le rassurer, jouer avec lui.
Il pourrait être mon fils
Et puis un jour, la dispute avec ma mère éclate. Je ne suis pas d’accord sur certains aspects de son éducation, je le défends contre mes parents, ma mère m’accuse. Je ne suis pas sa mère, je n’ai pas droit à la parole concernant l’éducation d’Aurélien, je me dois de ne pas saborder l’autorité de mes parents devant lui.
Et vous savez quoi ? Je m’en fous. Je ne suis pas sa mère, c’est vrai. Mais on me demande de m’occuper de lui comme si je l’étais. J’ai seize ans à l’époque, je suis capable de penser par moi-même, j’ai donc un avis sur tout et notamment sur comment éduquer un enfant (pas par des claques, pour commencer). Et en même temps, même si moi aussi je gronde Aurélien de temps en temps (c’est un vrai casse-cou, faut bien que je lui fasse comprendre qu’il y a des trucs dangereux, quand même), je suis avant tout sa soeur : devant les parents, tous unis contre l’ennemi !
C’est mon frère. On se serre les coudes, même s’il a zéro an et moi seize.
La séparation
Et puis un jour, j’ai dix-huit ans. Il est temps de partir pour la France faire mes études. Je suis ravie de m’expatrier, surtout pour aller vivre en France-le-pays-des-Danettes-et-du-saucisson, loin de mes parents que, comme toute ado, je trouve relous… mais voilà. Il y a mon frère.
Mon coeur de soeur se brise. Mon instinct maternel, développé malgré moi, me fait culpabiliser. Comment puis-je l’abandonner ? Oui, bien sûr, mes parents prendront soin de lui…mais mes vieilles terreurs se réveillent. Et si Aurélien manquait d’amour ? Et si je ne l’aimais pas assez, moi, suffisamment sans coeur pour vouloir aller habiter à 4000 km de là ? Et s’il mourait ?
Au moment de partir, à l’aéroport, mon coeur se brise en morceaux si infimes qu’ils se réduisent en poussière. J’ai peur que mon frère meure si je ne suis pas là pour veiller sur lui.
Jusqu’à aujourd’hui, cette peur ne m’a pas quittée. Elle s’est aggravée, bien entendu, avec la guerre civile qui fait rage en Syrie depuis 2011, exactement l’année où j’ai laissé les miens derrière moi pour partir étudier dans un endroit sécurisé. Et chaque nuit, plusieurs fois par nuit, je fais des cauchemars : mon frère meurt, de toutes les façons possibles et imaginables. Je ne suis pas là pour le protéger.
Une relation difficile, mais privilégiée
Mais, au fil des années, petit à petit, mon rôle de grande soeur s’affirme, et ma responsabilité en tant que « mère de substitution » s’estompe. Nous communiquons par Skype, et je me fais petit à petit à l’idée que mon frère n’est pas près de s’en aller. Ni de m’oublier. Nous nous parlons, il me raconte ce qu’il apprend à l’école, et me demande constamment quand je viens le voir. Il me demande de l’aider à écrire un email au Père Noël (eh oui, on est modernes chez nous !).
J’ai tout de même seize ans de plus que mon frère. Du coup, quand je suis en vacances chez ma mère et qu’elle n’est pas là, c’est moi l’autorité à laquelle mon frère doit se référer. Mais je vous rassure : il a très vite compris la différence entre ma mère et moi ! Quand je lui demande de faire quelque chose, il n’obéit pas toujours… et il faut que j’aille me plaindre à ma mère. Exactement comme une grande soeur ordinaire.
Peu à peu, je me fais à l’idée que je ne suis pas sa mère. Que c’est à mes parents de veiller sur lui, sur moi. Même si je ne compte pas dessus, même si je suis indépendante depuis le moment où j’ai mis le pied en France, je reste leur fille. Et leur rôle est de protéger leurs enfants. Moi, mon rôle, c’est de faire râler mes parents, de former une équipe avec mon frère, et de me concentrer sur mes études. Sur ma vie.
Mon frère, rebelote… au pluriel
Jusqu’à mes vingt ans, voilà donc ma vie. Et puis un jour, les choses basculent à nouveau. De manière totalement imprévue, mon père m’annonce que ma mère est à nouveau enceinte. Ce qu’il ne me précisera que des mois plus tard, c’est qu’elle est enceinte… de jumeaux !
J’entre dans une colère noire. Ma mère a cinquante ans et mon père un an et demi de plus, ils sont trop vieux pour avoir des enfants à cet âge, ils ne se rendent pas compte des risques que ma mère prend, ils ne pensent pas au futur de ces enfants dont les parents auront 70 ans lorsqu’ils en auront 20… Et surtout, je ne comprends pas. Mes parents qui ont toujours refusé d’avoir d’autres enfants lorsque j’étais petite, sous prétexte qu’ils avaient trop de travail avec mes maladies à répétition et leur manque de budget, décident d’avoir des jumeaux alors que mon frère demande énormément d’attention et qu’ils sont en plein milieu d’une guerre civile, dans un pays où le prix de la vie a quintuplé.
J’en veux à mes parents de mettre mes nouveaux frères en danger, alors qu’un obus peut tomber n’importe quand sur leurs petites têtes que je chéris tant.
À lire aussi : Congeler ses ovocytes, un progrès pour les femmes ?
Je vous passe les angoisses de la grossesse : j’étais en France et eux en Syrie, et je n’avais donc de nouvelles (plutôt rassurantes, heureusement) que par intermittences. Je retrouve mes cauchemars éveillés, j’ai onze ans à nouveau. Ma soeur vient de mourir. J’ai peur pour ces jumeaux. Je ne parviens pas à croire à un nouveau miracle… mon frère Aurélien était sûrement une exception, ces deux-là ne survivront pas.
Et pourtant. Contre toute attente, tout se passe bien. Ma mère accouche au Liban, dans une clinique spécialisée, j’attends avec mon père et mon frère dans la salle d’attente. Quelques heures plus tard, je vois mes deux nouveaux frères. Ils sont si beaux. Je me force à penser qu’ils ne vont pas mourir, qu’ils sont en bonne santé, je me force à y croire. Je n’ai pas le choix.
Mes frères et moi… nous, à quatre et malgré tout
Aujourd’hui, j’ai vingt-deux ans. Aurélien aura bientôt six ans, et Tristan et Maël, les jumeaux, bientôt deux. On ne trouvera pas sur Terre grande soeur plus fière que moi. Quand on me demande si j’ai des frères et soeurs, je dis oui, j’ai trois frères. Je n’oublie pas ma soeur. J’ajoute une pensée pour elle, en silence. Un jour, j’expliquerai à mes frères qu’ils n’ont pas une, mais deux soeurs. Un jour.
En attendant, je me bats toujours avec mes parents pour leur éducation, mais ma mère a déménagé en Turquie ; elle a donc rempli son rôle de mère protectrice. Alors, aujourd’hui, j’explique simplement que « mes frères ont mis du temps à arriver » sans m’étendre sur les détails : pas besoin de raconter ma vie à tout le monde.
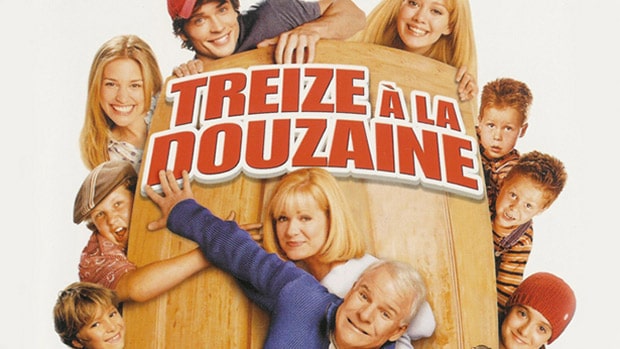
Mais surtout, j’en veux à tous ceux qui disent que « je ne connaîtrai pas mes frères » : oui, c’est sûrement vrai, je ne grandirai pas avec eux et donc je ne connaîtrai pas tout ce qui fait la vie de frères et soeurs ordinaires ; on ne se battra pas pour choisir la chaîne de télé (quoique), on ne se tirera pas les cheveux, on ne fera pas notre crise d’ado ensemble, et je ne vivrai pas l’effet de groupe… on m’a toujours considérée comme un individu à part entière et pas comme faisant partie « des enfants ».
Mais je fais tout ce que je peux pour connaître mes frères et leur montrer à quel point je les aime : je joue à des jeux de société et de dessin avec le plus grand, je l’appelle régulièrement pour qu’il sache que je pense à lui ; je chante des berceuses aux deux petits, et je leur offre des jouets sans prendre en compte le potentiel de bruit qu’ils produisent (m’en fous, je suis pas là !). Je les câline et les bisoute tous les trois, tout le temps que je passe auprès d’eux (deux fois par an, c’est pas beaucoup alors je me rattrape).
Non, je ne suis pas une enfant unique
Je suis une « enfant unique » parce que j’ai été élevée en tant que telle. Mais j’ai trois frères. Et ça personne ne peut le nier. Personne ne peut dire que mes frères n’ont pas de soeur, parce que je suis là autant que possible, que je les aime, et que je fais tout pour les rendre heureux. De loin, je ressemble peut-être plus à leur marraine qu’à leur soeur, c’est vrai. Mais je les aime comme une soeur ! En plus, Maël me ressemble énormément, paraît-il… et ça, j’en suis pas peu fière.
À tous ceux qui disent que je suis, en réalité, quand même une fille unique : non. Vous ne pouvez pas parler en mon nom, ni en celui de mes frères. Vous ne savez pas la relation qu’on a, tous les quatre. Vous ne savez pas que mon frère demande tous les jours à ma mère quel jour j’arrive. Vous ne savez pas que les jumeaux adorent quand je les chatouille. Vous ne savez pas que, encore aujourd’hui, je fais des cauchemars où mes frères meurent. Vous ne savez pas que, systématiquement, je prends la défense de mes frères contre mes parents. Vous ne savez pas que, en soeur irresponsable et non en mère, je les gâte autant que je peux.
Ce sont mes frères. Et personne ne pourra me les enlever. Je ne suis plus la même depuis qu’ils sont là. Et cette fois-ci, je m’assure de les aimer assez fort pour que jamais ils ne s’en aillent.
À lire aussi : Une femme née sans utérus a donné naissance à un bébé en Suède
Pour témoigner sur Madmoizelle, écrivez-nous à :
[email protected]
On a hâte de vous lire !
Et si le film que vous alliez voir ce soir était une bouse ? Chaque semaine, Kalindi Ramphul vous offre son avis sur LE film à voir (ou pas) dans l’émission Le seul avis qui compte.
































Les Commentaires
Et puis à 22 ans, j'ai déménagé à l'étranger, très loin et avec un gros décalage horaire. J'avais des nouvelles moins régulièrement (et j'en donnais moins) et quand il est venu me voir au bout d'un an, il avait poussé d'un coup et mué (il avait 14 ans). C'était mon frère mais en différent.
Ca m'a un peu brisé le coeur quand il à dit à ma mère qu'il savait pas trop se comporter avec moi. Parce qu'on s'est quitté à son entrée dans l'adolescence et que de mon côté, j'avais un job, un appart et que je vivais avec mon copain. Il devait avoir une image de moi très "adulte" (alors que pour moi j'étais toujours la même).
Je suis rentrée en France en 2012, l'année de mes 26 ans pour reprendre mes études et mon frère lui, avait 17 ans. Presque le même âge que certains de mes camarades de classe... Tellement étrange de côtoyer des jeunes du même âge que mon frère mais de toujours sentir qu'il y a un petit fossé entre nous. Il a changé, encore grandi et est devenu assez timide et introverti. Je sentais qu'il savait pas trop de quoi parler avec moi.
On est pas trop "nouvelles" dans la famille. Si on ne dit rien, c'est que tout va bien. Pas du genre à s'appeler pour se raconter nos journée mais j'essaie de me forcer à lui envoyer des textos pour prendre de ses nouvelles.
Depuis 2 ans, les choses ont un peu changées. Il a maintenant 20 ans et étudie à la fac de médecine. Il vient me voir à Paris et on profite de ces journées pour voir des films, papoter, faire les magasins. Notre relations n'est plus aussi proche que lorsqu'il était enfant et parfois je le regrette mais elle s'améliore. On rigole enfin tous les 2 et je sens qu'il n'est plus l'ado mal à l'aise qui ne savait pas quoi dire à sa soeur. J'espère que ca va continuer dans ce sens et qu'un jour on arrivera à retrouver le niveau de complicité qu'on avait en étant plus jeunes