C’est un sondage « à titre indicatif », mais néanmoins parlant : les contributeurs réguliers de Wikipédia en français se sont prononcés contre l’écriture inclusive.
Et je ne parle pas que du controversé point médian !
L’écriture inclusive, c’est quoi déjà ?
Quand je vois des gens « lambda » parler d’écriture inclusive, ils ne parlent généralement que de ses facettes les plus visibles (et débattues) : le point médian et les néologismes.
Remarque que, sur madmoiZelle, tu ne nous vois pas écrire « les étudiant•e•s » (on a abandonné le point médian) ni « celleux » (contraction de « celles » et « ceux »)…
Pourtant, les articles sont bel et bien rédigés en écriture inclusive, et ce depuis près de 8 ans !
Car nous écrivons « les infirmières et infirmiers » au lieu du classique « les infirmières ». Car nous écrivons « les patrons et les patronnes
» au lieu du traditionnel « les patrons ».
Car nous utilisons l’accord de proximité : « les étudiants et étudiantes sont allées » — on accorde au plus proche.
Car nous utilisons l’accord de majorité : « les lectrices de madmoiZelle » étant majoritairement des femmes, on parle d’elles au féminin.
Ce sont quelques exemples d’outils qui permettent d’écrire de façon inclusive… sans heurter la sensibilité des amoureux et amoureuses de notre bonne vieille langue française !
Les contributeurs francophones de Wikipédia disent non à l’écriture inclusive
Un sondage accessible aux personnes ayant édité au moins 50 éléments sur l’encyclopédie libre a permis à la communauté francophone de Wikipédia de se prononcer au sujet de l’écriture inclusive.
Je te rassure, ça ne portait pas que sur le point médian mais sur cette liste :
- L’utilisation de termes englobants ou épicènes lorsque c’est possible plutôt que les recours au masculin universel. Exemples : « le personnel de l’entreprise » plutôt que « les employés d’une entreprise ». « Les personnes contribuant à Wikipédia » plutôt que « les contributeurs ». Les « novices » plutôt que les « nouveaux ».
- Le recours à la double-flexion lorsqu’un terme englobant n’est pas possible. Exemple : « les contributeurs et les contributrices » plutôt que les « contributeurs ».
- L’accord en genre des noms et titres de fonction. Exemple : « la cheffe de service » plutôt que « le chef de service » s’agissant d’un homme.
- L’utilisation de l’accord de proximité ou de l’accord de majorité. Exemple : « l’étudiante et l’étudiant inscrits » plutôt que « l’étudiant et l’étudiante inscrits ».
- Le recours à des mots-valises masculin-féminin (dit aussi doublet abrégé), par exemple « salarié.e.s », « salarié·es », « salarié(e)s » sous diverses variantes typographiques.
- L’utilisation de termes non-binaires portant le genre masculin et le genre féminin simultanément à l’exemple de iel, celleux, contributeurice, etc.
Les deux dernières propositions ont été largement rejetées, par plus des ¾ des personnes sondées. Ce n’est pas surprenant, puisque ce sont celles qui se heurtent le plus aux codes de la langue.
Les autres propositions n’ont pas convaincu outre-mesure ; le résultat est moins tranché… mais pas vraiment positif non plus.
Pourquoi le Wikipédia francophone rejette l’écriture inclusive
Confort de lecture, accessibilité du texte… divers arguments sont avancés par ceux qui ont participé à ce sondage.
« Ceux », oui, et non « celles et ceux », car j’appuie ici le fait qu’une grande majorité des contributeurs, sur Wikipédia, sont des hommes.
C’est l’une des pistes de réflexion évoquées dans ce passionnant article de Numérama, que je te conseille de lire pour aller plus loin : Interrogée, la communauté Wikipédia française rejette massivement l’écriture inclusive !
À lire aussi : « Le masculin l’emporte sur le féminin », c’est nul : la preuve en vidéo
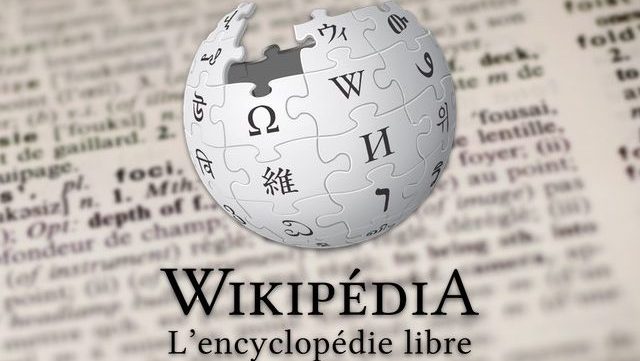




![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-28t150710132-768x432.jpg?resize=300,350&key=0dbf06ef)

![[Image de une] Horizontale (24) [Image de une] Horizontale (24)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/image-de-une-horizontale-24-768x432.jpg?resize=300,350&key=bd0cfdc3)


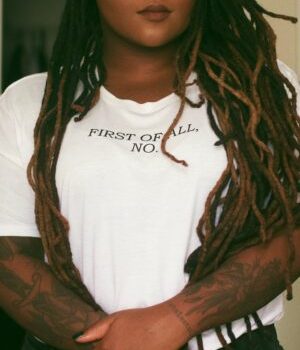






















Les Commentaires
@Bobbie in the Sky il y a plusieurs problèmes selon moi avec "chef/cheffe". A mes yeux, "chef" n'est pas censé être du masculin puisqu'on peut dire "le chef / la chef" sans que cela choque. Un peu comme "après-midi" qui peut être un/une, c'est pour moi ce qui se rapproche le plus du neutre en français.
Je n'y vois donc pas une neutralité du masculin, puisque le mot peut être considéré des deux genres.
Mais j'admets aussi que j'ai du mal avec l'idée que masculin / féminin ne soient pas neutres car je n'arrive pas à comprendre que des objets puissent avoir un genre (pourquoi "guitare" est féminin ? Pourquoi "violon" est masculin ? Ça n'a aucune logique à mes yeux). J'ai vraiment l'impression que le français a un énorme problème à ce niveau.
Quant à ma question, @Lady Stardust y a donné une réponse. Je me demandais, dans le cas où on est NB, si cette "guerre" entre féminin / masculin n'est pas pénible car au final, c'est mettre en avant le genre binaire, encore une fois. Alors que pour être vraiment inclusif, le plus simple serait de supprimer le genre sans compliquer la langue (comme disait je-sais-plus-qui, garder que le masculin qui est la forme la plus simple et adapter les pronoms si besoin d'indiquer le genre de la personne).
Je ne dis pas que vouloir égaliser les genres est une mauvaise chose ; mais plus je lis les messages sur Mademoizelle, plus je m'interroge car il me semble que le féminin n'est pas le seul genre à "remettre à niveau". Et plus encore, je pense que le genre n'est pas important (si j'apprécie quelqu'un, je m'en fous de son genre, je l'apprécie pour sa personnalité et ses actions unno.
En tout cas, c'est intéressant comme débat, j'apprends plein de choses, je pousse la réflexion et j'essaie d'avoir une vision plus juste du monde. Donc merci à tout le monde pour ces échanges