NB : Le prénom a été changé.
Tout a commencé en mai 2012. J’étais alors étudiante en deuxième année dans une licence d’économie qui ne me plaisait pas, dans une ville qui ne me plaisait plus. J’étais mal dans mes études, frustrée de faire de l’économie pour faire plaisir à papa/maman, alors que je rêvais d’enseigner.

Alors quoi, vous me dîtes de m’ennuyer encore, encore et encore, mais cette fois pour le reste de ma vie ?
J’avais néanmoins (car tout n’était pas non plus catastrophique) un copain formidable depuis sept mois. On s’aimait beaucoup, comme dans toute love story naissante. Et comme toute étudiante qui séchait (un peu beaucoup) les cours, j’ai trouvé une manière plus ludique de passer le temps. A savoir le sexe sans (trop) se protéger.
Un voyage inattendu
Je prenais la pilule, mais un jour, puis deux, puis trois, je l’ai oubliée. Mon copain était au courant de ces oublis mais, comme beaucoup de mecs de son âge, il voyait le préservatif comme une limite à son plaisir, et ne considérait pas que la contraception était son problème (NDLR : Il s’agit du point de vue particulier et personnel du petit-ami de cette madmoiZelle – la rédaction ne cautionne bien sûr pas cette opinion).
Nous avons eu un petit moment d’inconscience, d’égarement et de jeunesse dont on ne connaît réellement les conséquences que lorsqu’elles vagissent dans vos bras.
Je n’en étais pas encore à cette expérience extrême lorsqu’arrivée en fin de cycle, les règles si ponctuelles d’habitude ne venaient pas. J’avais déjà expérimentée cette petite angoisse auparavant. J’en ai glissé un mot à mon chéri pour plaisanter, croyant que c’était une fausse alerte. Cela a beaucoup fait rire les petits imbéciles que nous étions.
Sauf que cette fois-là, c’était pour de vrai. J’ai fait un premier test de grossesse : un petit trait marquait le positif, mais de façon faible. J’ai eu un semblant d’espoir ; après tout, les faux positifs ça arrive, et puis les filles de 21 ans qui tombent enceintes, on ne voit ça que dans les téléfilms pour mamie, hein.
J’ai fait un second test cinq jours plus tard – positif également. Mince. L’angoisse est montée d’un cran. Une amie m’a convaincue de faire une prise de sang. Le résultat le lendemain a indiqué un taux d’hormone HCG qui disait que j’en étais à trois ou quatre semaines de grossesse.
Je me suis d’abord dit que ce n’était pas possible. Que les tests étaient faux, que faire l’amour ne pouvait pas mettre dans de telles situations. J’avais eu des cours d’éducation sexuelle comme tout le monde après tout, j’avais eu mon bac avec mention ; je ne pouvais pas être enceinte, c’était pour les vieux, pour les gens mariés, les gens qui le voulaient – pas pour moi.
Mais le résultat était sans appel. Une chose qui était à moitié mon copain avait fait son nid dans mon utérus. Et ce mec que j’aimais et moi l’avions invitée ; moi en oubliant ma pilule, lui en persistant à laisser passer son plaisir en premier.
L’annonce et le choix
C’était trop dur à avaler, trop dur d’assumer. Trop dur de se dire qu’on a un choix à faire. Trop dur d’en parler à mon entourage. Pourtant, je devais au moins en parler au principal concerné : mon copain. Naïvement, je me suis dit qu’il saurait quoi faire et quoi me dire.
Mon résultat d’analyses en main, je me suis décidée à l’appeler.

Il était enchanté, naturellement… Il m’a accusée de l’avoir fait exprès, puis il m’a imposé l’avortement comme une nécessité, comme la condition pour qu’il me garde. Il ne voulait pas être père, et à ses yeux ce n’était qu’un embryon, qu’un haricot informe – rien du tout en fait. Juste des grosses règles.
Il estimait que c’était à moi de faire attention pour la contraception, puisque j’étais la seule de nous deux à en prendre une. Tout reposait sur moi, alors que nous étions deux à avoir fait n’importe quoi. Il ne s’est pas du tout remis en question.
C’était moi la coupable. Il m’a lancé : « Tu me dégoûtes. », lui, que je considérais naïvement comme l’homme de ma vie. Je n’avais pas pris de décision à ce moment-là. Je voulais prendre une voire deux semaines pour réfléchir à ce que chaque choix impliquait.
Curieusement, aucun de mes amis ne m’a soutenue. Aucun de mes amis ne m’a dit que c’était une bonne nouvelle. La première réaction a été celle de l’incompréhension de tout le monde. Des « Mais tu peux pas faire ça ! », « Mais tu vas rater ta vie ! » – à juste titre, je ne le nie pas. On m’a aussi dit que mon bébé serait forcément malheureux.
Je savais que chaque solution impliquait des sacrifices. Il n’y avait pas de bon ou de mauvais choix. C’était soit abandonner/me faire abandonner par mon copain et élever un enfant seule, et ainsi risquer mes études pas très brillantes jusqu’à présent ; soit avorter, et m’en vouloir toute ma vie. Garder l’enfant, et qu’il m’en veuille toute sa vie. Avorter, et souffrir. Accoucher et souffrir aussi.
J’ai tout pesé sur la balance. Et j’ai choisi, j’ai ouvert les yeux, j’ai découvert que je n’étais pas une super nana ultra-féministe qui soutient l’IVG inconditionnellement, qui met des slogans sur ses seins, qui n’hésitera pas à avorter pour être libre. Je me passais trop la main sur le ventre pour avorter. Je voyais déjà trop ce petit être dans mes bras pour avorter. Je ne voyais mon avenir qu’avec mon enfant avec moi, et tant pis pour le reste.
Il faut préciser que même si j’avais eu une éducation catholique, j’étais en train de quitter l’église (car je suis athée) au moment de la découverte de ma grossesse ; je n’ai donc pas du tout été influencée par ce milieu puisque je me détachais de la religion lorsque c’est arrivé. Je n’ai jamais été une pro-life, j’ai vraiment pesé l’avortement comme un choix possible. Mais je ne me suis pas sentie capable de passer à l’acte.
J’aimais mon embryon, mon « haricot » d’une manière tout à fait incompréhensible. Tant pis pour mon copain. Et je ne voulais plus être une gamine irresponsable : je voulais tout faire pour être une bonne mère. C’est aussi à ce moment-là que j’ai mûri. En un laps de temps très court. Mon bébé faisait déjà effet. Il m’a foutu ce coup de pied aux fesses que ni les chargés de TD, ni les parents n’avaient réussi à me foutre. Merci bébé.
Avoir ce bébé m’a en effet donné la force qui me manquait. J’étais en dépression, car je ne savais pas où je devais aller, si je devais m’efforcer de faire les études qui plaisaient à mon père ou aller à l’encontre de sa volonté en choisissant ma propre voie… Ce petit bidon m’a fait prendre conscience que pour lui comme pour moi, pour notre bonheur futur, il fallait faire ce qui me passionnait ; reprendre des études dans la branche qui m’attirait et les réussir.
Et je me suis rendu compte qu’il fallait trouver une solution pour assurer financièrement. C’était la condition pour garder le bébé ! Je me suis dit que si au jour de sa naissance, je n’étais pas capable d’assurer un train de vie pour lui et moi, ce serait l’accouchement sous X.
Je ne voulais pas mettre au monde un bébé qui serait d’office dans la misère, avec une mère dépassée ; je ne voulais surtout pas de la vie de damnée que certaines personnes de ma famille m’avaient prédite. Eux aussi d’ailleurs ont contribué à me booster, en me condamnant d’office !
Mon « chéri » m’a quittée la semaine après l’annonce de ma décision. J’étais un peu dégoûtée tout de même : c’est tellement injuste d’être une fille, de devoir assumer un coup tiré à deux toute seule. Je me disais cependant que c’était mon choix, et qu’il n’avait pas à être père s’il ne pouvait/ne voulait pas s’investir. Il n’avait pas choisi cette grossesse, et n’avait donc pas à s’impliquer.
En ce qui concerne ma famille, nous n’étions pas très proches : j’étais en froid avec mes parents depuis plusieurs années, pour diverses raisons. Cela n’a pas changé grand chose à la situation avec ma mère, mais, étonnamment, cela nous a rapprochés avec mon père, qui a dû être rassuré sur ma « maturité », et qui était ravi à l’idée d’être papy !
Mais à part lui, la réaction des gens autour de moi n’a pas été des plus bienveillantes. Pour l’anecdote, j’étais alors très investie dans un mouvement scout ultra-catholique, en tant que cheftaine principale d’un groupe de filles – avec uniformes, prières et tout le tralala. Quand j’ai annoncé que j’étais enceinte à ma responsable, j’ai été renvoyée très gentiment sur ordre du dirigeant national qui estimait que je n’avais pas à m’occuper d’enfants catholiques en raison de mon « mode de vie ». Ah. Aime ton prochain, comme ils disent.
Mes camarades d’économie ont été surpris, et certains qui ne m’appréciaient pas ont été carrément choqués, et m’ont accusée de l’avoir fait « dans le dos » de mon copain qui était très apprécié au sein de notre filière. On m’a traitée de cas social, de fille perdue, de folle, de psychopathe, et que sais-je d’autre…

Bonne ambiance.
J’ai quitté la ville accablée de honte, un peu comme une Fantine des temps modernes en somme… J’ai alimenté les ragots quelques mois. Et le « papa » du bébé m’accablait de tous les torts, ce qui n’arrangeait absolument rien.
Grossesse et études
J’ai eu du mal à accepter le rejet du père du bébé ; il m’arrivait de pleurer en imaginant mon bébé sans son papa pour le regarder grandir. Mais je me suis ressaisie presque aussitôt ; j’avais d’autres chats à fouetter. J’ai changé de ville car je ne voulais pas que mon « état » s’ébruite plus, dans l’intérêt de mon désormais ex-copain comme pour moi.
Mon bébé m’a donné la force de faire ces démarches que je détestais tant, de changer mon appart qui n’était absolument pas propice à l’arrivée d’un enfant, de changer de ville et de reprendre la fac. J’en avais le souhait au fond, et je n’y arrivais pas parce que j’étais focalisée sur mon échec en droit : il a été LE déclic qu’il me fallait.
En septembre 2012, j’ai ainsi commencé une deuxième année de licence d’anglais : j’ai repris ma vie en main. J’en étais à quatre mois et demi de grossesse, sans copain mais avec un petit bidou.
Et de toute façon, les choses s’annonçaient bien. Même bébé allait bien. Il était parfait sur l’échographie. Il bougeait et me faisait déjà craquer – des instants magiques. Quand les cours ont commencé, je me suis sentie épanouie ; j’adorais ce que je faisais.
J’ai senti le bébé bouger pour la première fois pendant un cours de littérature américaine. Je me sentais douée pour quelque chose, enfin. Un soir, sans prévenir, mon ex m’a écrit. Il voulait des nouvelles, il voulait connaitre le sexe du petit. Il voulait qu’on discute. Je n’ai pas refusé cette main tendue. On a parlé, longtemps, et on s’est rendu compte qu’on s’aimait encore ; on voulait se voir, on avait besoin de se donner une chance.
On s’est revus, et tout semblait pardonné. Je lui ai dit que je ne souhaitais pas qu’il reconnaisse le bébé à tout prix, parce que c’était mon choix de ne pas avorter, et que je ne souhaitais rien imposer à personne. Tous ces éléments l’ont sans doute rassuré. Il s’était fait tout un film, à penser que je voulais l’arnaquer, lui faire un bébé dans le dos pour avoir une pension, ou que sais-je. Mon attitude lui a montré que ce n’était pas du tout le cas.
Il a embrassé le ventre, et lui a parlé. On s’aimait, et on s’est mis à attendre ce bébé ensemble. Il m’a accompagnée aux échographies. Et moi, j’ai obtenu mon premier semestre avec la mention bien – une belle revanche sur toutes les personnes qui m’en avaient dit incapable.
Le neuvième mois est arrivé. Puis les contractions. J’ai accouché en février 2013, trois jours après l’annonce des résultats du semestre. Elle est là, c’est une fille et elle s’appelle Alice. Mon copain l’a reconnue ; nous sommes une vraie famille, c’est écrit sur le livret de famille !
Valider son année avec un bébé ? Même pas mal.
Non, ce n’est pas vrai. Ça fait mal. Mon copain étudie à quatre heures de chez moi. On se voit tous les quinze jours le temps d’un week-end toujours trop court. Je gère la petite toute seule – je ne veux pas qu’il ait l’impression d’avoir raté sa vie.
Heureusement, financièrement, j’assure grâce aux aides dont je bénéficie. C’est (parfois) un gros avantage d’être une maman étudiante, car cela ouvre le droit au RSA et à toutes les aides liées à la parentalité.
Quand votre famille ne subvient pas à vos besoins, c’est formidable. Dans une petite ville, il est possible de vivre correctement – pas dans le luxe, mais correctement. C’est tout de même un stress en moins !
Heureusement, on m’a envoyé les cours de l’université après la naissance d’Alice : j’avais demandé une place en crèche, mais il n’y en avait pas avant septembre 2013. Les délais sont toujours très longs. Il m’était donc impossible d’assister aux cours – et nous n’étions qu’en mars. Aïe.
Alice était allaitée, et demandait toute mon attention. Je ne me lavais plus les cheveux, moi qui les entretenais si bien, et mes seins gonflés par le lait m’avaient transformée en vache laitière. J’ai retrouvé mon vieux jogging pourri du collège ; les mini-jupes et les petits slims n’étaient plus vraiment d’actualité… Il n’était pas vraiment question de sortir – d’ailleurs mes amis ont commencé à râler.
Alice a mis sept mois à faire ses nuits. Je peinais à lire mes bouquins de cours en lui faisant des câlins, et je n’avais pas toujours le temps de faire la sieste.

T’étais pas supposée dormir tout le temps, toi ?
Il fallait bosser et pouponner, et la semaine des partiels le défi était aussi de ne pas me laisser déconcentrer par les gorgées de lait qui fuyaient sournoisement pendant que je galèrais sur ma copie de linguistique…
Dans tout ce joyeux bazar, j’ai validé mon année ; une chance, un petit triomphe personnel. Je me suis prouvé que je pouvais le faire. J’ai prouvé aux personnes qui m’ont jugée que je l’avais là, au fond de mes tripes. Je l’ai fait pour Alice, pour moi et pour mon copain.
Maman et étudiante, oui
Je me sens moins « stigmatisée » et jugée dans ma fac : la plupart des étudiants sont très gentils avec moi. Certains sont très compréhensifs, et voient que ce n’est pas facile ; on me rassure quand je craque (car forcément, ça arrive).
D’autres refusent cependant de m’envoyer les cours quand je suis absente parce que la petite est malade ou parce que je n’en peux plus : il considèrent que c’est une excuse bidon et que je ne mérite pas mon diplôme – l’université me donnant un statut particulier d’étudiante salariée, je ne suis évaluée que sur la base du partiel final.
On ne m’invite pas non plus aux soirées entre copains de promo, car je ne suis sans doute plus assez « cool » pour ça. Nous naviguons dans des univers différents ; eux dans les licornes et Rihanna, moi dans les couches, les popos et les grandes questions existentielles. Je dois dire que je m’entends désormais mieux avec les « vieux » qui sont déjà parents et qui connaissent mes tracas de mère.
Au moment où j’écris, je suis dans les révisions de la troisième année. J’ai eu mon semestre 5. Je le veux ce dernier semestre, je suis déterminée. La petite est à la crèche depuis septembre 2013, comme prévu. En parallèle des études (car je suis tarée et que j’aime multiplier les difficultés n’est-ce pas), je bosse en tant qu’Emploi Avenir Professeur dans un lycée, à raison de douze heures par semaine.
Je veux passer mon CAPES, voire mon agrégation. J’ai été prise en Erasmus en Irlande pour l’année prochaine. Ma fille a 14 mois. Mon copain et moi nous installons ensemble à la rentrée. On s’aime toujours, on sait où on va, et où on veut aller pour elle et pour nous.
Alors oui, je pars de rien. Oui, mon choix était irresponsable au départ. Mon attitude était irresponsable aussi ; ce bébé est tout de même là parce que je me croyais à l’abri et vivais dans un « Ça n’arrive qu’aux autres ! » total. J’avais tellement tort.
Mais avec de la motivation, de la volonté, de l’organisation et, surtout, avec l’amour que l’on porte à son bébé, c’est possible. C’est un sacré défi, formidable, difficile, mais dingue.
Pour témoigner sur Madmoizelle, écrivez-nous à :
[email protected]
On a hâte de vous lire !
Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.






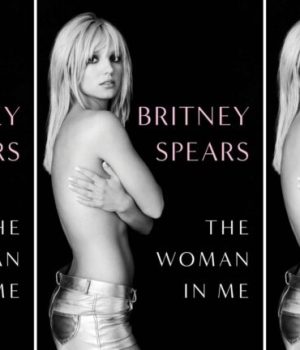



























Les Commentaires
Le seul moyen de ne pas payer la pension est d'accepté le test mais de ne pas être le père.