— Article publié initialement le 22 novembre 2011
Les prémices : la crise d’ado
Comme à peu près tout le monde, en quatrième, j’étais mal. Mal dans ma peau, mal dans ma vie. Je passais mes week-ends et mes soirées à lire, les pieds sur le radiateur, face à la fenêtre, emmitouflée dans ma couette comme dans un cocon.
Souvent, je restais là, sans rien faire, mon livre dans les mains, pour donner l’illusion à mes parents que j’étais occupée. Mais ce que je regardais, c’était le ciel, gris dans mes souvenirs ou noir pendant la nuit. Je regardais le ciel, et je voulais disparaître.

Je ne dis pas que je voulais mourir, bien que l’idée m’ait traversé l’esprit, mais que je n’aie jamais été jusqu’à la mettre en œuvre. Non, je voulais juste… cesser d’exister. Et je me laissais couler peu à peu, au chaud dans mon cocon, recroquevillée aussi à l’intérieur.
Au moindre contact humain, avec mes parents ou mes camarades de classe, l’émotion me submergeait : envie de pleurer (depuis, j’ai dans ma famille la réputation d’être « hypersensible »), de m’enfuir et surtout, surtout, cette peur terrible, cette angoisse irraisonnée.
À lire aussi : Comment j’ai appris à accepter mon hypersensibilité
Ça a duré environ deux ans. Mon entourage a mis ça sur le compte de la crise d’ado. En vérité, je me rends compte aujourd’hui que j’avais tous les symptômes de la dépression :
- Fatigue et sentiment permanent de n’avoir aucune énergie ni aucune force pour quoi que ce soit
- Tristesse immense, envahissante
- Alternance entre périodes d’insomnies et périodes d’excès de sommeil
- Dévalorisation constante (« Je ne sers à rien, je suis nulle, personne ne m’aime »)
- Culpabilité à propos de ces émotions (« C’est vrai, moi j’ai de quoi manger et un endroit où vivre, c’est le syndrome de la pauvre petite fille riche, je n’ai pas le droit de me sentir aussi mal sans raison »)
- Crises d’angoisse
- Peur permanente de tout
- Confusion intellectuelle, avec l’impression que mon cerveau avance dans des sables mouvants et la moindre contrariété qui se transforme en problème énorme et insoluble.
Bien évidemment, à l’époque, je n’en ai parlé à personne. Principalement à cause de ce sentiment de culpabilité. Ma mère fait partie de ces personnes qui ne se plaignent jamais, ne vont jamais chez le médecin, ne s’écoutent pas. Quand j’étais malade, elle me disait « Arrête ton cinéma ».
Comment pouvais-je lui parler de mon mal-être ? Elle ne m’aurait pas écoutée, ou se serait moquée de moi. Alors j’ai vécu, ou survécu, comme je pouvais, et finalement, à mon entrée au lycée, j’avais retrouvé le goût de vivre.
Ma première dépression : sans médicaments
En deuxième année de master, je vivais en colocation avec mon frère. La cohabitation était difficile, surtout depuis qu’il avait décidé d’installer sa petite amie à l’appart sans me demander mon avis (notons qu’il devait passer dans ma chambre pour aller dans la sienne : espace vital de rêve).
Le stress des études, le fait de cumuler master, petit boulot et recherche de stage, le fait aussi que mon copain de l’époque habite à l’autre bout de la France… Petit à petit, je me suis laissée couler, et ma bonne vieille meilleure ennemie, la dépression, est revenue me hanter.
Comme je m’en aperçois maintenant, c’est l’hiver qui en est le premier déclencheur. Comme tout le monde, je suis sensible à la baisse de lumière, à ces jours qui raccourcissent, à ce froid et à ce ciel gris et maussade (« Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle », c’est pas moi qui l’ai inventé).
Peu à peu, la déprime hivernale habituelle s’est changée en dépression. Je dormais en cours. Je pleurais en moyenne cinq fois par jour. Je me souviens du réveillon de Noël de cette année-là : j’ai pris le train pour rentrer chez mes parents et j’ai pleuré dans le train, tout le long du trajet, alors que les fêtes de Noël avaient toujours été un plaisir pour moi.
En février, c’est à ma gynéco, au Planning Familial (une femme exceptionnelle, à l’écoute, je la remercie encore du fond du cœur aujourd’hui) que j’en ai parlé, en pleurant à chaudes larmes, moi qui n’étais venue que pour un renouvellement d’ordonnance contraceptive.
À lire aussi : Sonia Eguavoen et Anthony Agbele, deux sages-femmes féministes qui font DU BIEN !
Elle m’a dirigée vers l’assistante sociale, avec qui j’ai eu quelques rendez-vous. Le médecin que j’ai vu ensuite m’a proposé des médicaments. Mais les antidépresseurs me faisaient (et me font toujours) très peur : produits puissants, peur de devenir dépendante, sentiment d’échec (un médicament pour quelque chose qui n’existait que dans ma tête, ça me paraissait idiot).
Finalement, après un déménagement, j’ai retrouvé peu à peu un équilibre, sans médicaments. Mais voilà : saviez-vous que lorsqu’on a fait une dépression, on est beaucoup plus vulnérable à une autre ? En gros, la dépression est une maladie chronique…
Deuxième dépression : avec antidépresseurs
En décembre 2010, je travaillais pour un directeur dont le comportement était à la limite du harcèlement moral. Ma famille à l’autre bout de la France me manquait.
Et c’est là que mon copain de l’époque, pour qui j’avais déménagé loin de ma famille pour trouver du boulot plus près de lui, a décidé de me tromper avec son ex pour qui, je m’en suis rendu compte plus tard, il avait toujours eu des sentiments depuis leur séparation. Trahison, mensonge. Tout s’écroulait autour de moi.
Je ne vous fais pas un dessin : la dépression est revenue. J’ai démissionné. Je suis retournée vivre chez mes parents. Mais la cohabitation était houleuse (je ne me suis jamais aussi bien entendue avec eux que lorsque j’étais à l’autre bout de la France) et la dépression s’était cette fois bien installée.
À lire aussi : 4 signes montrant qu’il est grand temps de quitter le domicile de vos darons
Je n’arrivais à faire aucune démarche, ni à chercher du travail. Ma mère ne comprenait pas mon attitude, elle me trouvait paresseuse, pensait que je « me la coulais douce » depuis que j’étais revenue à la maison.
Bien sûr, elle était inquiète pour moi et essayait de me secouer. Mais elle m’enfonçait chaque fois un peu plus sans le vouloir. Je n’avais pas besoin d’être secouée. J’avais besoin d’être soutenue.
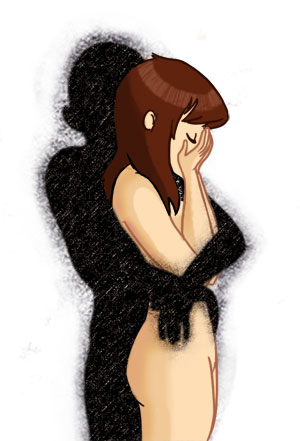
J’ai fini par aller voir notre médecin de famille, qui m’a convaincue de prendre des antidépresseurs. Je ne vous dirai pas que ça a été magique. Il faut quelques semaines pour que l’effet des médicaments se fasse sentir. Et à vrai dire, c’est à peine si on le remarque au début. Pas d’oiseaux qui chantent dans la tête, ni de vie en rose.
Simplement, au bout d’un certain temps, je me suis rendu compte que je ressassais moins d’idées noires, que j’avais plus d’énergie pour faire ce que j’avais à faire, qu’en entretien d’embauche, j’arrivais à me vendre correctement. En y repensant, c’est comme si on avait appuyé sur le bouton « off » de mon émotivité.
Ce n’est pas que je ne ressentais plus rien. Mais, là où avant j’aurais pété un câble pour une tasse de café renversée, maintenant, je me levais, je prenais une éponge, et j’essuyais avant de me refaire un café. Avec mon nouveau petit ami, je ne ressentais plus cette jalousie maladive que j’éprouvais auparavant, et qui était en fait une conséquence de la profonde dévalorisation due à l’état dépressif. Il me parlait de ses ex et je l’écoutais calmement en me disant que de toute façon, il était avec moi maintenant.
À lire aussi : Comment avoir confiance en soi ? — Les conseils des madmoiZelles
Je me disais que c’était peut-être ça, d’être « normale », sûre de soi. Aujourd’hui encore, je regrette d’être redevenue « humaine », avec mes émotions trop fortes. Et c’est justement cette pensée qui me fait peur, car elle s’approche de la dépendance.
Les antidépresseurs m’ont aidée à sortir la tête de l’eau, mais ils me font peur parce qu’on peut en devenir dépendant•e.
Oui, les antidépresseurs m’ont aidée à sortir de cet état de torpeur, à remonter la pente (ou plutôt, car je préfère cette image, à pousser avec les pieds au fond de la mare pour remonter à la surface). Mais ils me font peur, parce qu’ils s’apparentent à une drogue, et qu’on peut en devenir dépendant•e.
Quoiqu’il en soit, à la fin de l’été, j’ai commencé à réduire les doses, puis à arrêter complètement, sans problème particulier, ni effet rebond (il y a un risque de rechute plus grave si on arrête trop soudainement ce type de médicaments).
Je ne fais pas pour autant l’apologie des antidépresseurs. Ils m’ont toujours fait peur, et selon moi, prendre des médicaments est, encore aujourd’hui, un signe de faiblesse et d’échec.
Et maintenant ?
Ce qui m’a poussée à écrire ce témoignage, c’est ma visite chez le médecin hier soir. Elle est revenue. Et de nouveau, on m’a prescrit des médicaments. Moins forts, certes, mais des médicaments tout de même. Parce que je n’arrivais plus à assurer au travail, parce que j’étais triste en permanence.
J’ai voulu prendre les devants, reconnaissant l’haleine fétide de cette poufiasse brumeuse. Mon médecin ne m’a proposé que des médicaments, alors que je recherchais plutôt une aide psychologique, un accompagnement, un coaching pour en sortir définitivement.
En sortir définitivement ? Je ne sais même pas si c’est possible. Et maintenant j’ai peur. Peur de mon avenir. Peur de fonder une famille, et d’imposer ça à mes futurs enfants, à mon futur mari. Je le vis comme une fatalité. Peut-être que j’ai tort. Dites-moi que j’ai tort…
— Illustrations Timtimsia
Pour témoigner sur Madmoizelle, écrivez-nous à :
[email protected]
On a hâte de vous lire !
Ajoutez Madmoizelle à vos favoris sur Google News pour ne rater aucun de nos articles !















![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-06-03T152331.664 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-06-03T152331.664](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/06/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-06-03t152331664-768x432.jpg?resize=300,350&key=402d1b58)












![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-03-01T143149.814 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-03-01T143149.814](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/03/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-03-01t143149814-768x432.jpg?resize=300,350&key=d9a4be76)





Les Commentaires
Elle est venue s'incruster cinq fois, cette poufiasse.
La première, j'avais dix ans, deux ans d'avance et j'étais victime de harcèlement scolaire. Je n'ai su que plus tard que j'avais été malade, mais putain, le terrain que ça a préparé...
La seconde, j'avais quinze ans, je venais de subir une orientation forcée après que l'on m'ait dit que mes résultats étaient insuffisants pour entrer en bac scientifique et réaliser mon rêve de devenir vétérinaire, le harcèlement avait recommencé, je ne montais plus à cheval alors que ça avait (a) toujours été mon échappatoire... Ce coup-ci, j'étais plus renseignée, j'avais conscience de ce qui se passait, mais il était hors de question que j'en parle - comme toi, ma mère vient d'une famille dans laquelle "on ne s'écoute pas".
La troisième a été terrible; j'avais dix-huit ans et c'était suite à ma démission de la ferme équestre dans laquelle je travaillais et qui était toute ma vie. J'ai essayé de me faire aider, mais la psychiatre que j'ai vu n'a fait que me prescrire des anti-dépresseurs sans me proposer de thérapie donc je lui ai claqué la porte au nez et j'ai déchiré l'ordonnance.
La quatrième, c'était il y a bientôt deux ans quand j'avais vingt-deux/vingt-trois et ça a été encore pire, au point que j'ai failli y passer. J'avais finalement décidé de me réorienter pour réaliser mon rêve et j'étais partie étudier la médecine vétérinaire en Belgique, mais ça s'est très mal passé dès le début et je suis retombée malade à la vitesse de l'éclair, pour finir aux Urgences dans un semi-coma et avec une seule phrase à la bouche: "je veux mourir". Sauf qu'entre-temps, j'avais rencontré mon psychiatre, un médecin formidable à qui je dois la vie; et j'étais déjà sous anti-deps, mais ça n'a pas suffi.
C'est pourquoi la cinquième est arrivée l'année dernière, quand j'ai fait mon entrée en Master pour faire plaisir à mes parents alors que j'étais encore totalement traumatisée par mon échec en Belgique. Et là encore, j'ai manqué mourir, parce que les pulsions suicidaires sont revenues avec une violence inouïe. Sauf que cette fois, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et j'ai demandé à être hospitalisée. J'ai passé un mois dans une clinique psychiatrique et ça a changé ma vie.
Aujourd'hui, je ne dirais pas que je suis guérie, d'autant que mes antécédents familiaux font que la maladie fera peut-être toujours partie de ma vie, mais je vais bien. Je suis blindée de médocs avec tous les effets secondaires que cela implique, je vois mon psychiatre toutes les trois semaines et ma psychothérapeute une fois par semaine, ainsi qu'un psy spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire, je retourne à la clinique chaque Mardi pour participer à un groupe de parole sur les TCA justement, j'ai toujours des moments d'immense tristesse, j'ai les larmes aux yeux dès que je croise un SDF, je fais régulièrement des crises d'angoisse, j'ai beaucoup de mal à dormir malgré les somnifères, l'alimentation et le rapport au corps et au poids restent très compliqués pour moi et j'ai agrandi ma collection de cicatrices, mais je profite de ma vie et j'ai envie qu'elle continue. Et surtout, je suis fière de moi et du chemin que j'ai parcouru - même si je sais qu'il me reste encore un bon bout de route à faire.
Alors oui, je partage tes inquiétudes pour l'avenir: est-ce qu'elle va revenir, quid de mes autres troubles psychiques (anxiété, insomnies sévères, personnalité tendant vers le borderline, anorexie-boulimie, comportements auto-destructeurs...), est-ce que je pourrais avoir une vie "normale", un travail, un copain, des enfants, d'ailleurs est-ce que c'est raisonnable de vouloir des enfants connaissant l'hérédité pourrie que je leur transmettrais...
Mais j'ai pris (et on m'a fait prendre) conscience que je ne pouvais pas savoir tout ça, et que ce qui compte, c'est le présent. Ça paraît hyper cul-cul mais à chaque fois que tu souris devant un chien qui remue la queue / un bébé dans sa poussette / une vidéo à la con, c'est une petite victoire contre la maladie. Or il n'y a pas de petites victoires, comme dirait l'autre. Donc "connecte-toi", aux autres, à la nature...
Accumule les expériences positives, et essaye de faire fi de ce sentiment de culpabilité omniprésent (c'est méga-dur, je sais). Les médocs, ben... ça fait chier, c'est clair, et je connais ce sentiment d'échec, mais il faut ce qu'il faut, et si ça te permet par exemple de partir en randonnée à cheval dans les Pyrénées et d'y passer l'un des meilleurs moments de ta vie comme cela a été mon cas en août, fais avec et dis-toi que ça ne sera pas pour toujours.
Dans tous les cas, répète-toi cette parole de la chanson "Jennifer" de FAUVE, qui m'aide souvent et m'a permis d'aider mes camarades de lutte à la clinique: "Le jour se lèvera, forcément au moins une fois".
Des bisous, prends soin de toi et de ce qui t'es cher