Madmoizelle. Sur Instagram, où tu comptes près de 300 000 followers, tu partages des tranches de vie de ta patientèle et tu te racontes aussi à travers elle. Est-ce que ton sixième roman, « Où vont les larmes quand elles sèchent » peut-être vu comme une extension de ton Insta ?
Baptiste Beaulieu. Oui et non. C’est surtout que j’avais une volonté de raconter aux gens mon métier. Qu’est-ce que c’est être médecin généraliste aujourd’hui, en 2023 ? Je suis parti un peu de la manière dont je parle de tout ça sur Instagram, parce que c’est ma voix. J’écris comme je pense ou comme je parle. Mais il y avait vraiment aussi une volonté d’en faire un objet livresque qui puisse dépasser le média qu’est Instagram. Les gens qui aiment lire ne sont pas forcément sur ce réseau social et vice versa. Ma volonté première, c’était de faire découvrir mon métier,dire aux gens ce que c’est que d’être médecin, ce que c’est que d’être soignant.Venez avec moi dans mon cabinet, soyez au-dessus de mon épaule et puis regardez.
« Où vont les larmes quand elles sèchent » raconte le quotidien de Jean, d’un médecin généraliste et les vies de ses patient·es. Le format de l’autofiction s’est-il naturellement imposé à toi ?
Oui, parce que j’avais envie de parler du réel. Et le réel, il fait la queue à mon cabinet médical. Et en même temps, je suis romancier et je n’ai pas envie de me mettre une contrainte de l’autobiographie stricte. L’autofiction, c’est ce qu’il y a de mieux dans ce cas-là pour pouvoir dire les choses sans les dire et puis s’autoriser la toute puissance du romancier, qui est celle aussi d’ajouter de la chair à des squelettes d’histoire. Tout est vrai, mais évidemment que j’ai mis de la chair autour des squelettes.
Violences conjugales, charge mentale, sexisme des médecins ou encore moins d’études sur les maladies qui touchent en majorité les femmes… Tes convictions féministes transpirent dans ce roman. Est-ce que ton métier de médecin t’as rendu plus sensible à la cause de celles que tu appelles affectueusement les « frangines » ?
Avant d’être médecin généraliste, j’ai eu le parcours assez banal d’un garçon blanc, issu d’une classe moyenne, qui fait des études, qui l’amènent à un métier où il deviendra quelqu’un d’assez privilégié dans la société. Et pour tout te dire, je n’étais absolument pas militant. Je n’étais d’aucune cause, aucune lutte. Et j’ai commencé à m’y intéresser, d’abord quand j’ai décidé d’être qui j’étais par rapport à mon orientation sexuelle. J’avais eu des copines avant. Tu passes du statut d’une personne lambda dans la rue à une personne qui tient la main d’un garçon et les autres s’autorisent d’un seul coup à juger ton couple. Tu deviens une sorte de sous-citoyen. Ça m’a mis du plomb dans la tête.
Et effectivement, tu as raison, c’est le cabinet médical. Je mets au défi n’importe quel mec de recevoir 40 patients par jour, dont 70 % de nanas et de ne pas se sentir profondément ébranlé par la somme de privilèges qui sont les nôtres, simplement parce qu’on est né homme dans cette société. Et il y a un truc, je ne comprends pas : pourquoi les médecins ne sont-ils pas plus militants ? Pourquoi ils ne sont pas plus féministes, pourquoi ils ne sont pas plus de gauche ! C’est un métier qui est quand même très étiqueté à droite. Quand on voit ce qu’on voit au cabinet médical, comment est-ce qu’on peut rentrer chez soi et se dire : ‘ok, la société me va telle qu’elle est’ ? C’est un truc qui est venu petit à petit, le sentiment de colère, se dire ‘ce n’est pas normal’. C’est injuste ce qui se passe, c’est injuste envers les femmes, c’est injuste envers l’ouvrier, c’est injuste envers un tel… Et puis, à force de rentrer du travail en se disant que c’est injuste, un jour on rentre chez soi et on n’est plus la même personne.

Dans ton roman, tu écris : “Ça manque vraiment aux gens, d’avoir quelqu’un qui s’intéresse à eux. Juste de temps en temps.” Est-ce que ce ne serait pas ça, entre autres, qui manque à la médecine moderne : l’attention portée à l’autre ?
C’est déplorable, mais avec les conditions d’exercice actuelles, on n’a plus assez de médecins par rapport à une population vieillissante. Et quand les populations vieillissent, elles sont davantage consommatrices de soins. Le souci, c’est que du coup, on a moins de temps pour les écouter. On a de plus en plus de patient·es. On n’est pas assez nombreux. Et donc, évidemment, la médecine, la qualité de l’écoute s’en ressent. On en devient maltraitant, et c’est souvent, malheureusement, à notre corps défendant.
Je te donne un exemple. Une patiente vient dans mon cabinet. Elle se met à pleurer. J’essaie de l’écouter du mieux que je peux. Et puis, les minutes passent et la salle d’attente est pleine de gens qui ne sont pas bien non plus. Et à un moment, j’ai le malheur de regarder dans le coin inférieur droit de l’ordinateur, là où il y a la petite horloge. Elle voit mon regard et me dit aussitôt : ‘excusez-moi, je vous prends du temps, je suis désolée’. Je m’en suis voulu qu’elle voit ce regard. Et je me suis dit, mais quelle société est-on devenu, où les gens s’excusent de pleurer ? Cette anecdote illustre bien ce qu’est devenue la médecine d’aujourd’hui. Je pense que beaucoup de médecins ne sont pas satisfaits de leur situation, de leurs conditions d’exercice et ont conscience que pour les patients, ce n’est pas bien.
Il y a justement cette question des larmes en fil rouge du roman. Jean n’arrive plus à pleurer depuis qu’il n’a pas pu sauver un enfant. Pourtant, il en croise des destins qui pourraient lui faire verser une larme. Pourquoi c’est si important pour lui, pour toi, de faire couler ces larmes ?
Pendant les études de médecine, on tombe sur des vieux médecins qui nous disent : « il faut que vous laissiez vos émotions de côté, parce que ce à quoi vous allez assister durant toute votre vie professionnelle est extrêmement dur. Vous ne pouvez pas vous laisser gouverner par vos émotions ». Je me souviens d’un médecin qui m’a dit : « Tu es trop empathique, tu ne pourras pas faire ce métier comme il faut ». Et je crois que malheureusement, il y a une part de moi qui, jour après jour, finit par s’anesthésier à la souffrance de l’autre. On ne devrait pas, mais ça arrive. Et il arrive un matin où tu t’aperçois que tu n’es plus capable de pleurer. Alors, ça tient aussi, peut-être, à la socialisation masculine, à la manière dont on apprend à devenir un garçon. Mais peut-être aussi que ça tient au fait d’être médecin. Tu vois des choses difficiles et tu mets des couches et des couches au-dessus de ton cœur, qui deviennent de plus en plus dures, comme de la corne, que tu mets sur tes émotions. Et je me demande : est-ce que quelqu’un qui ne sait plus pleurer est vraiment capable de faire ce métier ?
On a plein d’exemples de gens qui me disent ‘mon médecin a été maltraitant’, il ne m’a pas écouté, il a été sec. Il faut se souvenir que le patient ne voit qu’un soignant. Moi, dans la journée, j’ai vu 35 personnes. Le soir, je vais rentrer, tous les visages vont se confondre. Le lendemain, je vais passer à autre chose. Mais le patient, qui a besoin de réponses à ces questions, il n’aura vu qu’un seul visage, le mien. Si ce visage n’a pas été à l’écoute, s’il n’a pas été capable d’accueillir sa plainte, le patient s’en souviendra. Alors que moi, je ne m’en souviendrai plus deux jours plus tard. On a une responsabilité par rapport à ça. Je pense que c’est fondamental de s’en rappeler tous les matins, de se dire : « Je serai le seul visage qu’ils vont voir aujourd’hui, le seul visage de soignant qui peut apporter des réponses à leurs questions ». Juste se souvenir de ça.
Tu as écrit un roman tragi-comique, qui emprunte parfois aux codes du conte. J’ai eu l’impression de lire « Le fabuleux destin de Baptiste Beaulieu », où l’arène n’est plus Paris mais un cabinet médical. Comment trouves-tu cet équilibre entre rires et larmes, dans un parcours comme celui de la féministe Josette, qui apprend qu’elle a un cancer du sein ?
En fait, mon roman est un reflet assez fidèle de mes journées au cabinet médical. L’hôpital, c’est une sorte de vaudeville. Tu ouvres une porte, tu ris, tu ouvres une autre porte, tu pleures. Et c’est comme ça tout le temps ! Le cabinet médical, c’est la même chose. Tu vois 40 patients qui viennent à ta table pour se confier dans la journée. C’est 40 histoires de vies différentes. Et la vie, évidemment, elle n’est pas toujours sombre. Parfois, elle est sombre et en même temps, elle est extrêmement drôle.
C’est aussi la raison pour laquelle je m’interdis d’arrêter un jour d’être médecin. Parce que les livres fonctionnent bien et sans doute que je pourrais ne vivre que de ça. Mais je ne crois pas aux romanciers dans sa tour d’ivoire. Je pense qu’il faut être avec les gens, avec la vie, être avec leurs éclats de rire, avec leurs larmes aussi. Et ça, ça ne peut se faire qu’en étant au cabinet médical, en ayant les mains
dans le cambouis humain, dans ce qu’il y a de plus beau et aussi dans ce qu’il y a de plus triste ou de plus tragique. Ça ne peut pas se faire tout seul chez soi. On ne peut pas parler du monde sans être au cœur du monde.
C’est ce que j’essaye de montrer dans le livre. Le monde est plein de choses, et dans ce plein de choses qui sont très chaotiques, le pire peut côtoyer le meilleur. Et la tragédie peut côtoyer la comédie.
Quelle partie du roman a été la plus difficile à écrire ?
C’est la fin, où je parle de ce que j’ai vécu enfant et que j’avais besoin d’écrire dans un roman. En fait, je l’ai écrit dans chacun de mes romans. Il n’y a pas un seul de mes romans qui ne parle pas d’une agression sexuelle à un moment donné et j’avais besoin de l’écrire noir sur blanc, de le mettre dans un livre avant l’arrivée de mon fils, pour solder les comptes avec le passé. Je pensais que ça m’aiderait. Ça n’a pas été le cas.
Il est beaucoup question de la mort dans ton roman. Est-ce que la côtoyer de si près alimente chez toi d’éventuelles angoisses ou cela apaise-t-il au contraire ton rapport à la mort ?
J’ai un rapport beaucoup plus apaisé qu’avant à la mort. Par contre, le vieillissement du corps et la dégradation physique, ça, c’est autre chose. Quand tu côtoies des personnes qui ont eu des AVC, ont des séquelles terribles et sont devenues des sortes de de poids mort pour leurs épouses, car c’est souvent des épouses qui s’en occupent… Tu te dis : ‘mon Dieu, mais je ne veux pas être ça un jour pour mon compagnon’. Le rapport à la mort, ça allait beaucoup mieux jusqu’à la naissance de mon fils, où là, je t’avoue, j’ai repris un petit coup derrière la tête. On se dit, mais s’il arrive quoi que ce soit ? Et en même temps, je ne suis pas très inquiet, parce que j’ai tellement de nanas super autour de moi, qui seront au taquet pour s’occuper du petit avec mon compagnon. Le rapport à la mort, il change dans le sens où tu t’aperçois que le problème, ce n’est jamais ta mort. C’est la manière dont tu vas faire souffrir les gens en partant. J’ai un patient qui m’a dit ça un jour. Il m’a dit : ‘pourquoi faut-il qu’on aime tant de gens avant de partir ?’ Et il avait raison. C’est ça la vraie question. C’est tout cet amour. Il faut bien qu’il aille quelque part à la fin.
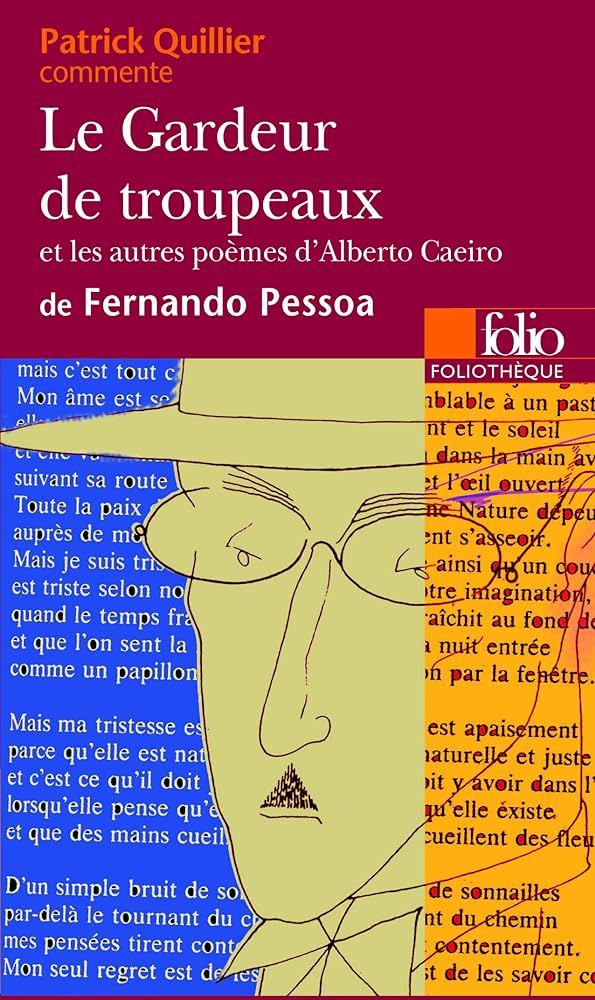
L’art m’a beaucoup aidé, c’est sûr. Je parle souvent du recueil de poèmes Le gardeur de troupeaux de Fernando Pessoa, qui m’a aidé à accepter certaines choses, comme l’injustice. C’est la plus belle Bible laïque qu’on puisse lire. Tous les soignants sont un jour ou l’autre confrontés à ce moment charnière dans la vie d’un être humain, qui est la mort d’un enfant. Quand tu es à l’hôpital, tu es jeune soignant, tu te dis, on est là pour soigner, pour accompagner, pour sauver. Et puis un jour, tu es confronté à la mort d’un enfant, et tu te dis, là il y a quelque chose qui cloche dans la grande machine. Soit Dieu est tout puissant mais pas tout bienveillant parce qu’il a laissé faire ça, soit ce n’est pas Dieu. Tu as plein de questions d’un seul coup. Et la question principale, c’est pourquoi le mal existe ?
Je pense que c’est une question fondamentale, autant pour les croyants que les non-croyants. Pourquoi on se fait autant de mal ? C’est aussi l’objectif que j’avais en écrivant ce livre, alors qu’on était en plein dans la guerre en Ukraine, mais ça vaut aussi avec ce qui se passe en ce moment (la guerre israélo-palestinienne, ndlr). Je voulais écrire un grand livre humaniste. Un livre qu’on lirait avec le sourire aux coins des lèvres, en se disant ‘oui, on est ça aussi’. On n’est pas que des gens qui envoient des bombes sur des hôpitaux. J’avais envie de procurer un petit refuge, ce lieu sanctuarisé qu’est le livre, pour oublier un petit peu la part sombre de l’humanité.
Ton travail d’écrivain est intrinsèquement lié à ton métier de médecin. C’est ta soupape de décompression ?
Je crois beaucoup au pouvoir de la contrainte chez le romancier. Quand je suis au cabinet médical, je ne peux pas écrire. Je sens les mots qui s’accumulent, l’imagination qui pousse derrière. Et d’un seul coup, c’est la fin de la journée. Et là, c’est comme un flot ininterrompu de mots qui viennent parce que je me suis retenu toute la journée. L’écriture n’est pas une soupape. Peut-être que j’écrirai moins bien ou moins tout court si j’avais la possibilité d’écrire tout le temps.
Ce qui est certain, c’est qu’on vit des situations difficiles. Une fois, j’ai reçu une femme, son mec lui avait coupé le nez. Elle avait une prothèse. Décrire ça, raconter cette scène, son sourire, son histoire… Déjà, elle n’est pas perdue pour toujours son histoire. Ça, ça me terrifie, l’idée que tout ce que je vois au cabinet soit perdu pour toujours. Oblitéré, tombé, dans un trou, qu’on n’en parle plus jamais. J’ai un sentiment de gâchis immense. C’est aussi pour ça qu’il faut écrire, pour se rappeler de ces gens.
Tu es nouvellement parent d’un petit bébé : ça te donne des idées pour ton prochain roman ?
Je t’avoue qu’en ce moment, j’ai un tout petit peu de mal à écrire, avec les nuits ultra-courtes ! Ce qui est certain, c’est que j’ai envie de parler d’homoparentalité, de mon parcours, en tant que personne qui n’était pas destinée à fonder une famille. J’ai envie de raconter comment nos enfants et les enfants de nos enfants vont modifier profondément cette société. Je ne vois pas comment mon enfant ou les enfants de mes copines lesbiennes pourront grandir en étant homophobes ou lesbophobes. Et il y aura cette idée que l’arbre généalogique a commencé par deux mecs ou deux nanas. Je me dis que c’est aussi sur un temps long qu’on va arriver à faire bouger les lignes au sein de la société.
Où vont les larmes quand elles sèchent de Baptiste Beaulieu, L’Iconoclaste, 272 pages, 20,90 €.
Et si le film que vous alliez voir ce soir était une bouse ? Chaque semaine, Kalindi Ramphul vous offre son avis sur LE film à voir (ou pas) dans l’émission Le seul avis qui compte.






![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-15t163147788-768x432.jpg?resize=300,350&key=c0e2a724)
![[Image de une] Horizontale (24) [Image de une] Horizontale (24)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/image-de-une-horizontale-24-768x432.jpg?resize=300,350&key=bd0cfdc3)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-16T173042.478 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-16T173042.478](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-16t173042478-768x432.jpg?resize=300,350&key=e6ae1102)


![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-08-27T142659.508 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-08-27T142659.508](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/08/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-08-27t142659508-768x432.jpg?resize=300,350&key=2861f644)






![Copie de [Image de une] Horizontale (94) Copie de [Image de une] Horizontale (94)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/01/copie-de-image-de-une-horizontale-94-768x432.jpg?resize=300,350&key=4cb8a791)


![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-05-22T164945.311 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-05-22T164945.311](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/05/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-05-22t164945311-768x432.jpg?resize=300,350&key=638f1da8)


![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-28t150710132-768x432.jpg?resize=300,350&key=0dbf06ef)
![[Image de une] Horizontale (26) [Image de une] Horizontale (26)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/image-de-une-horizontale-26-768x432.jpg?resize=300,350&key=3f4065eb)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-17T105447.652 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-17T105447.652](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-17t105447652-768x432.jpg?resize=300,350&key=46422db2)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-09-19T102928.481 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-09-19T102928.481](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/09/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-09-19t102928481-768x432.jpg?resize=300,350&key=c8084f21)
![[Image de une] Horizontale (18) [Image de une] Horizontale (18)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/08/image-de-une-horizontale-18-768x432.jpg?resize=300,350&key=1a90e2f6)





Les Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaire sur cet article.