— Article initialement publié le 29 août 2013
Je suis née. Violette et fripée. Il faisait froid, il y avait beaucoup trop de lumière et manque de bol, j’étais visiblement tombée dans un pays pauvre où les gens n’avaient que des vêtements en papier à se mettre sur le dos.
Épuisée, je n’aurais pas refusé une petite sieste. Je leur ai hurlé « Mais laissez-moi dormir ! » et ils ont eu l’air ravis. Ils m’ont posée sur le ventre de ma mère qui était encore fort bombé : c’était aussi facile que d’essayer de dormir sur une balle de gymnastique .
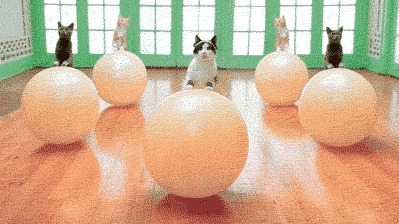
De toute manière, je n’ai pas pu souffler bien longtemps puisqu’on m’a aussitôt collée dans une bassine transparente et glissante. Là, de vieux inquisiteurs sont arrivés, avec leurs flashs de lumière aveuglante. Ils voulaient visiblement me faire parler mais je n’ai pas dit un mot. Une fois la nuit tombée, j’étais seule mais terrorisée : pourquoi m’avait-on couchée dans un plat à gratin Pyrex ?
Je passai donc ma première nuit — ou plutôt ma première insomnie — terrifiée à l’idée que quelqu’un ne revienne et ne m’embarque au beau milieu de la nuit pour m’enfourner à 180°C telle une vulgaire tartiflette.

Personne ne sut jamais ce qu’il advint des jumeaux de la chambre 312.
Par la suite, les choses s’améliorèrent légèrement. Si on veut. Je fus confiée à deux geôliers (des « parents », dans leur jargon) qui me cloîtraient dans une cage, chaque nuit. Comme toute détenue, j’avais droit à une promenade quotidienne, dans un engin de torture appelé « landau » dont le matelas en mousse me brisait les lombaires. Toujours pas moyen de dormir.
Au parc, je croisais d’autres compagnons d’infortune qui avaient tenté de s’échapper mais ils finissaient toujours par être rattrapés.
http://youtu.be/sDaRLZF9HqY
À trois ans, avec 5673 heures de sommeil manquantes à mon actif, j’entrai d’un pas fatigué à l’école maternelle. Le landau était trop petit depuis longtemps mais je retrouvais mon ennemi juré, le matelas en mousse, chaque jour, durant la sieste obligatoire. La scoliose prit définitivement ses quartiers dans ma colonne vertébrale.
Pendant un temps je crus que tout allait s’arranger. Mes geôliers avaient en effet remplacé ma cage par un petit abri de bois monté sur pilotis : mon premier lit.

Un truc un peu comme ça, bricolé avec trois bouts de ficelle et deux cageots de légumes.
De là-haut, surplombant mon royaume de Playmobils, je crus pouvoir enfin me reposer. Mon bonheur fut de courte durée. À peine me l’avaient-ils offert que mes parents mirent le lit en vente. Un déménagement se préparait.
Je me demandais quelle serait ma nouvelle paillasse dans la maison (d’arrêt) où je serai transférée. Pour coller à l’ambiance carcérale, mes geôliers m’offrirent un lit en fer forgé. J’ignore où ils avaient pêché cette idée : peut-être dans les trop nombreux dessins animés qui considèrent qu’une petite fille doit souffrir pour trouver le sommeil ?

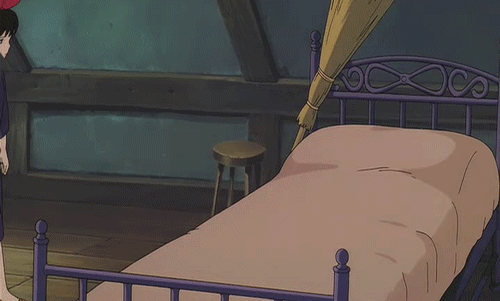
Arrêtons le massacre des lits en fer forgé.
Se cogner aux bords ou à la tête du lit devint mon pain quotidien. Mes insomnies revinrent à vitesse grand V. Je craignais qu’un intrus ne pénètre dans la pièce à la nuit tombée et ne démonte l’un des barreaux métalliques du lit pour me transpercer avec. Comme vous le voyez, mes cauchemars étaient forts créatifs, preuve que j’étais une enfant sereine et reposée.
À l’adolescence; je gagnai le droit de choisir mon mode de couchage. Malheureusement mon cerveau, irrémédiablement attaqué par ce manque de sommeil, me fit prendre les pires décisions. J’enchaînais les bonnes idées pour mal dormir.
- Le lit mezzanine : séance d’escalade quotidienne histoire de bien se réveiller avant de s’endormir, coups multiples contre le plafond et mort certaine assurée en cas de crise de somnambulisme.
- Le futon : dormir à même le sol. Quelle bonne idée, vraiment. Un sommier ça ne sert à rien et surtout pas à préserver son dos.
- Le hamac : faut-il vous faire un dessin?

Le comble c’est qu’il m’arrivait de cumuler. Je disposais alors d’un lit mezzanine sous lequel était suspendu un hamac en-dessous duquel un vieux matelas défoncé était jeté. Autrement dit j’avais trois modes de couchages différents et pas un pour rattraper l’autre. C’était brillant !
Ce qui me donnait encore la force de me lever le matin c’était la certitude que j’allais bientôt être libre et choisir le lit de mes rêves en quittant le nid familial. Il serait spacieux, moelleux et doux.
Une fois encore mes espoirs furent réduits à néant. La malédiction frappa et voulut que je passe mes deux premières années étudiantes en internat. Dans une chambre individuelle. Certes. Mais dans une chambre de 6 m².
Une chambre-couloir si étroite qu’elle ne pouvait accueillir qu’un bureau et un lit (au-dessus du bureau). La retour de la mezzanine vengeresse, mais en pire cette fois-ci puisque le lit faisait moins de 90cm de large. Les matelas fournis étaient probablement ceux équipant les cabines des sous-marins.
Comme je ne pouvais pas m’étirer dans mon lit —je ne pouvais même pas m’étirer dans ma chambre — je pris l’habitude de m’étaler durant les cours. Les tables me semblaient délicieusement confortables. Vous aussi, vous les auriez trouvées séduisantes si vous n’aviez pas fermé l’oeil depuis vingt ans.
J’avais donc appris à somnoler n’importe où et en toute circonstances, et je rêvais du temps où je quitterai l’internat.

En emménageant dans mon premier appartement je fis l’acquisition de mon premier… lit. Tout aurait dû se résoudre mais j’avais oublié de me poser la question essentielle : un clic-clac (au rabais) est-il réellement un lit ?
Disons que ce n’était pas si mal. Il s’agissait d’un pseudo-lit qui avait le mérite d’avoir DEUX places. Et c’est là qu’était tout le problème. Ce n’est qu’une fois mon indépendance conquise que j’ai compris l’incroyable chance que j’avais eu de dormir seule durant toute mon enfance.
Désormais, il faudrait partager avec Gérard. Gérard était fort aimable : c’est d’ailleurs lui qui m’a aidé à ramener le dit clic-clac du Conforama. Mais du coup il comptait bien l’occuper à 50%.

Mais pousse-toiiiiiiiii !
On n’est jamais tranquille ! Entre le reste des études, les échanges à l’étranger (« ça ne vaut pas le coup d’investir pour 6 mois, prenons donc un lit en carton ») et les déplacements professionnels qui empêchent tout sédentarisation, je pense que je n’aurai pas un lit décent avant 2028.
Mais je ne perds pas espoir. Au pire je me ferai préparer un cercueil bien cosy, tout matelassé de soieries, pour profiter de mon trépas en toute tranquillité… Ou pas.
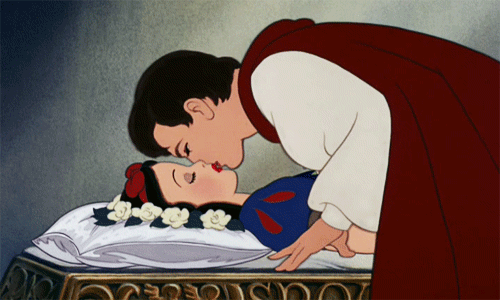
Mais bordel, même au fond d’une forêt, on peut pas dormir tranquille ?













![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-06-03T152331.664 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-06-03T152331.664](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/06/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-06-03t152331664-768x432.jpg?resize=300,350&key=402d1b58)












![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-03-01T143149.814 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-03-01T143149.814](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/03/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-03-01t143149814-768x432.jpg?resize=300,350&key=d9a4be76)





Les Commentaires